 |
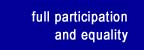 |
|
 |
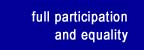 |
|
AD HOC COMMITTEE ON
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| Documents and contributions |
| NGO Participation |
|
Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des handicapés Tendances et thèmes nouveaux relatifs à la promotion des handicapésRapport du Secrétaire général |
|
Table des matièresI. Nouvelles formulations du concept de handicap
II. Collecte et analyse de données et de statistiques sur les personnes handicapées |
1. Avant l’adoption du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, la démarche adoptée dans le cadre des politiques et des programmes consistait généralement à associer le handicap à des individus. L’action était ponctuelle et principalement axée sur le traitement médical, la réadaptation et la protection sociale, l’objectif étant d’améliorer la réinsertion des handicapés dans les structures sociales dites normales. En ce qui concerne la prévention de certaines causes de handicap, le fait que les politiques et les institutions pouvaient créer des obstacles à la pleine participation et à l’égalité des handicapés en tant qu’agents et bénéficiaires du développement [1] a été peu examiné. Les objectifs du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées –la pleine participation et l’égalité– indiquent que la communauté internationale se place sur le vaste plan des droits de l’homme. L’objectif relatif à l’égalité des chances permet d’orienter les actions prioritaires de manière que les deux objectifs du programme puissent aboutir à des résultats concrets. Les problèmes des handicapés du point de vue du développement ont reçu une attention supplémentaire au niveau politique suite à la déclaration prononcée par Vicente Fox, Président du Mexique, dans le cadre du débat général de l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session. Dans son allocution, le Président Fox a lancé un appel à la communauté internationale afin que celle-ci place au premier plan la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il a déclaré que le monde ne deviendrait pas plus juste si certains groupes étaient exclus de ce processus et a indiqué que le Mexique proposait la création d’un comité spécial chargé d’étudier l’élaboration d’une convention pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés [2] .
2. La nouvelle formulation des concepts de handicap accorde une attention spéciale à l’élimination des obstacles et à la promotion d’un environnement accessible aux handicapés, dans lequel ils pourront davantage participer, sur un pied d’égalité, à la vie sociale et au développement. Les participants à la Réunion interrégionale d’experts sur les moyens de subsistance durables et les handicapés, accueillie à Jakarta, du 15 au 17janvier 2002, par le Gouvernement indonésien ont identifié trois catégories d’obstacles que les handicapés devaient surmonter pour pouvoir disposer de moyens d’existence durables: a)l’adaptation au handicap et la maximisation de la capacité fonctionnelle, b)l’interaction avec la communauté et la société et c)l’accès à des activités économiques et sociales donnant un sens et un but à l’existence. Pour réunir ces conditions, il faudrait appuyer les stratégies de réadaptation maximisant les capacités fonctionnelles (et sociales) des handicapés, formuler des stratégies visant la participation et l’autonomisation des handicapés afin de faciliter leur participation pleine et effective à la vie communautaire et économique, et promouvoir des stratégies visant à prévenir ou à éliminer des obstacles injustifiés ou des conditions invalidantes dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la conception des infrastructures, notamment en ce qui concerne les constructions, les transports, l’environnement professionnel, les technologies de l’information et les systèmes de communication.
3. Les résultats des recherches sur ce sujet montrent qu’il n’existe pas qu’un seul moyen d’aborder les problèmes des handicapés du point de vue du développement. Certaines études tendent à considérer les handicapés comme un groupe minoritaire, et ce davantage parce qu’ils subissent les préjugés et les discriminations du reste de la population qu’en raison de l’existence d’obstacles matériels à leur participation pleine et effective [3] . Selon le modèle du groupe minoritaire, tous les aspects de l’environnement sont influencés par les politiques publiques puisque celles-ci reflètent les comportements de la société. Les aspects de l’environnement matériel, social et économique qui aboutissent à des discriminations contre les handicapés ne peuvent être considérés comme des événements fortuits ou de simples coïncidences [4] . Toute action doit s’attaquer aux attitudes de la population à l’égard des handicapés qui permettent et renforcent les préjudices et les discriminations dans la société. Selon d’autres études, l’examen des questions relatives aux handicapés sous l’angle des droits de l’homme est différent d’un examen sous l’angle des facteurs liés à l’environnement [5] . Les auteurs de ces études considèrent que l’optique des droits de l’homme tient compte de droits que tous les individus peuvent revendiquer, qu’ils soient handicapés ou non. Ce type d’approche met l’accent sur la manière dont la société marginalise les handicapés et sur les moyens de transformer l’environnement social afin de le rendre plus ouvert [6] . Les approches du point du vue du développement ont un thème commun qui consiste à prévenir l’exclusion (l’abandon des handicapés dans des institutions) et à promouvoir l’ouverture, l’autodétermination, l’égalité et la pleine participation.
4. L’Assemblée générale, dans sa résolution 52/82 du 12décembre 1997, a fait de l’accessibilité une priorité dans le cadre de l’égalisation des chances des handicapés. L’expérience semblerait montrer que mettre l’accent sur l’accessibilité permet de neutraliser les phénomènes d’exclusion et de renforcer l’égalité des chances de manière positive et durable. Cette question étant particulièrement complexe, il convient d’étudier systématiquement le concept d’accès pour qu’en profitent les processus d’élaboration des politiques.
5. L’accès n’est ni une action ni un état, mais la possibilité de choisir librement d’entrer, d’approcher, de communiquer ou de tirer parti d’une situation [7] . L’environnement s’entend de l’ensemble ou des éléments d’une situation à laquelle accède le handicapé. La participation sur un pied d’égalité serait possible si l’égalisation des chances était permise par des mesures augmentant l’accessibilité. Les éléments de l’accessibilité sont des attributs des possibilités qu’offre un certain environnement, sans être des caractéristiques de celui-ci. Ainsi, dans le domaine des soins de santé, Pechansky et Thomas définissent l’accès comme un «concept représentant le degré d’“adéquation” entre les clients et le système [8] ». En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, cinq caractéristiques ont été définies: l’offre, l’accessibilité, l’adaptation, le coût abordable et l’acceptabilité [9] . Selon les résultats des recherches concernant la réadaptation des handicapés, leur environnement peut être décrit selon cinq caractéristiques:
6. Les caractéristiques de l’égalité ainsi définies, plutôt qu’un outil pour classifier ou évaluer un environnement donné, représentent en fait un schéma de classification des différentes interactions entre les individus et leur environnement. L’accessibilité n’est qu’un des cinq aspects qui caractérisent un environnement accessible ayant été définis.
7. Le principe de conception universelle fournit un point de départ pour l’évaluation de l’accessibilité se référant à l’interaction entre chaque personne et son environnement. Ce principe offrant une conception des produits et des environnements permettant leur utilisation maximale par tous [11] , les critères universels en matière d’accès devraient: a)reconnaître le contexte social; b)prendre en considération la situation de chaque personne, c)tenir compte des facteurs de l’âge et de la culture et d) appuyer les analyses portant sur l’individu et l’environnement. S’appuyant sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’Organisation mondiale de la santé [12] , les participants à une réunion d’experts organisée par l’ONU en coopération avec l’Université de York (Toronto) ont défini les critères ci-après qui permettent d’évaluer l’accès :
8. Les évaluations de l’environnement s’appuyant sur les critères universels relatifs à l’interaction entre l’individu et son environnement offrent notamment la possibilité de passer en revue les variables en matière d’accessibilité et d’identifier les solutions permettant de réduire l’exclusion sociale et d’appliquer les droits de chacun. L’accessibilité n’est pas le sujet de préoccupation d’un groupe social particulier mais une condition essentielle au progrès de tous.
9. Dans certains textes issus de conférences et de réunions au sommet internationales, par exemple dans le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 26 août-4 septembre 2002) [14] , on constate une tendance à classer les personnes handicapées parmi les groupes vulnérables de la population. Cette tendance traduit un mode de pensée qui assimile les handicapés à un groupe minoritaire et fait d’eux une population à risque en raison d’un déficit physique, sensoriel ou moteur. Toutefois, la vulnérabilité n’est pas une question examinée dans le Programme d’action mondial. Les données indiquent que l’incapacité est un aspect normal de la vie et que chacun, à tout moment, peut en être atteint sous une forme ou sous une autre [15] . L’analyse doit donc faire de la vulnérabilité une variable qui s’applique à tous.
10. À sa trente-sixième session (New York, 10-20 février 1998), la Commission du développement social a examiné la notion de vulnérabilité dans le contexte des stratégies visant à promouvoir l’intégration sociale. Elle a noté que la vulnérabilité était une notion qui concernait tous les individus, qui étaient tous exposés à divers risques, mais que les risques n’étaient pas également répartis dans la population. Elle a également noté que l’on pouvait identifier trois dimensions de la vulnérabilité: a)les risques, ou la probabilité d’être victime d’un traitement injuste; b)l’état mental; et c)les conséquences. Dans ses conclusions concertées, la Commission a indiqué que les politiques visant à réduire la vulnérabilité devaient notamment se fonder sur une bonne compréhension du risque de pauvreté et d’exclusion sociale, viser à renforcer les réseaux et organisations de la société civile, tenir compte des aspects de la vulnérabilité liés au milieu physique, c’est-à-dire faire la distinction entre les zones rurales et les zones urbaines et accorder une attention particulière à l’éducation des enfants à tous les niveaux de manière à assurer aux handicapés les mêmes possibilités d’éducation à tous les niveaux [16] . Pour la Commission, ce qui détermine dans une large mesure la vulnérabilité d’un groupe de population, c’est la mesure dans laquelle les politiques et les programmes sont intégrateurs, viennent en aide aux collectivités et aux familles et assurent à tous les mêmes possibilités d’accès aux programmes et aux services. Les handicapés sont vulnérables s’il y a perte ou limitation des possibilités qui leur sont offertes de participer à la vie normale de la collectivité, dans des conditions d’égalité, en raison d’obstacles physiques ou sociaux [17] .
11. Tant le Programme d’action mondial que les Règles définissent les handicapés en se référant à la terminologie mise au point par l’Organisation mondiale de la santé dans la Classification internationale des handicaps, déficiences, incapacités et désavantages. Cette classification repose sur une approche médicale; elle vise à décrire les conséquences de la maladie, du traumatisme ou du trouble au niveau d’une fonction précise du corps (statut biomédical), de la personne (structures et fonctions du corps) ou de la société (handicaps, déficiences, incapacités et désavantages) [18] . Elle suppose un lien causal entre les handicaps, les déficiences, les incapacités et les désavantages dans lequel les facteurs liés au milieu physique ne jouent aucun rôle, alors qu’ils ont une influence certaine sur l’incidence de l’incapacité dans la société [19] .
12. Contrairement à la Classification de l’OMS qui s’inscrit dans un contexte médical, certains analystes ont mis au point une approche de l’incapacité qui repose sur les modes de vie et dans laquelle l’analyse porte non plus sur les aptitudes physiques, sensorielles ou de développement mais sur les possibilités qui s’offrent dans la société. Comme l’indique le tableau ci-dessous, les unités d’analyse sont la personne, la famille, la société et l’environnement plus général. L’analyse tient compte des changements du cycle de vie alors que la Classification de l’OMS reste statique.
Le handicap considéré non plus sous l’angle de l’aptitude mais sous celui des activités menées dans la vie courante
| Catégorie de handicap | Définitions de l’aptitude de l’individu | Activités menées dans la vie courante |
| Orientation | Recevoir les signaux environnants et y répondre | Échange d’informations |
| Autonomie physique | Vivre sans aide ni assistance | Choix |
| Mobilité | Se déplacer dans son milieu physique | Voyage |
| Occupation | Occuper son temps à des activités normales | Utilisation réelle du temps |
| Intégration sociale | Participer aux relations sociales normales | Relations réelles |
| Autonomie économique | Exercer une activité socioéconomique | Contrôle des ressources économiques |
| Transition* | Préparation à des changements de vie |
Source pour les catégories de handicaps et les définitions de l’aptitude de l’individu: Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des handicaps, déficiences, incapacités et désavantages: A Manual of Classification relating to the Consequences of Disease (Genève, Organisation mondiale de la santé, 1980).
* N.B.: La «transition» n’est pas mentionnée dans la Classification de l’OMS.
13. En mettant l’accent non plus sur les aptitudes individuelles mais sur les situations de la vie courante, l’analyse est centrée non sur une activité donnée mais sur les résultats qu’un individu obtient au quotidien dans son milieu physique. C’est l’accès de l’individu au choix des décisions qui déterminent son bien-être et ses moyens de subsistance sans recourir à une aide qui est la question clef. Dans ce sens, l’autonomie économique est analysée en fonction non pas de l’aptitude de l’intéressé à gagner sa vie, mais de la mesure dans laquelle il peut influer sur ses ressources économiques et les maîtriser. La variable possibilités ne s’applique pas seulement à l’individu. Les politiques et les programmes en faveur des familles des handicapés ont des incidences sur la gamme des choix qui s’offrent à elles pour ce qui est des voyages, de l’utilisation du temps, des relations sociales et de la maîtrise des ressources économiques. Ils peuvent être examinés en termes de résultats pour les handicapés et non par rapport à un groupe de population précis.
14. Un deuxième élément du nouvel univers des incapacités a trait à la transition, en particulier au vieillissement de la population. Il a été examiné pour la première fois dans le troisième rapport d’examen et d’évaluation du Programme d’action mondial (A/52/351) et analysé dans le Plan d’action international sur le vieillissement adopté à Madrid, dans lequel il est noté qu’entre 2000 et 2050, le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus dans la population devrait doubler, passant de 10 à 21% et que dans les pays en développement, le pourcentage de personnes âgées devrait passer de 8 à 19% d’ici à 2050 (A/CONF.197/9, résolution1, annexe II). Il est indéniable que le vieillissement entraîne une transition et des changements de vie du fait de la diminution de certaines aptitudes physiques et sensorielles. Cela ne suffit pas, toutefois, pour inclure les personnes âgées parmi les handicapés. Le problème de fond tient au fait que, à mesure que la population vieillit, le pourcentage d’individus atteints d’une déficience plus ou moins importante – mais qui ne sont pas handicapés – augmentera. D’où l’importance de formuler et de prendre en compte dans le budget des politiques visant à rendre le milieu physique accessible et à permettre l’acquisition [20] d’appareillages.
15. Le troisième élément du nouvel univers des incapacités a trait à la nécessité de tenir compte des groupes de populations qui comprennent des personnes atteintes de troubles mentaux ou qui souffrent de maladies graves et évolutives [21] . Par exemple, dans son deuxième rapport de suivi (E/CN.5/2000/3 et Corr.1), le Rapporteur spécial sur les personnes handicapées a appelé l’attention, en particulier, sur la situation des personnes atteintes de handicaps d’ordre psychiatrique ou liés au développement, notant qu’elles étaient souvent parmi les plus marginalisées de la société et qu’il était donc important de préparer l’intégration à la société et d’améliorer les conditions de vie de celles qui devaient être placées en institution.
16. Des questions analogues se posent dans le cas des individus atteints de maladies graves et évolutives, par exemple du VIH/sida. Lutter contre une maladie grave exige des ressources qui pourraient autrement être consacrées à la mise en oeuvre de politiques et de programmes en faveur des handicapés. Un grand nombre de ceux qui vivent avec le sida ou d’autres maladies graves ont souvent besoin des mêmes services que les handicapés «classiques». Dans certains pays, les politiques ou les lois nationales sur l’invalidité protègent les personnes atteintes de maladie grave et évolutive. Les pays où ce n’est pas encore le cas doivent de toute urgence élaborer les politiques nécessaires pour protéger les droits et la dignité de ces personnes. Toutefois, les inclure parmi les handicapés met en lumière le lien entre invalidité et état de santé. Les défenseurs des handicapés ont toujours cherché à dissocier handicap et santé pour que la société ne considère pas les handicapés comme des «malades». Des données de plus en plus nombreuses indiquent que les handicapés risquent davantage de contracter ce qu’on appelle des «troubles secondaires». La formulation de politiques permettant de prévenir les troubles secondaires chez les personnes atteintes de handicap est un objectif important des politiques publiques et montre qu’il est urgent de réexaminer les notions de base et la terminologie de l’invalidité.
17. L’une des conséquences des diverses dimensions du nouvel univers des incapacités est qu’il faut réexaminer – et mettre à jour en conséquence – l’estimation selon laquelle une personne sur dix est atteinte d’un handicap, laquelle figure dans le Programme d’action mondial (A/37/351/Add.1 et Add.1/Corr.1, par.37) et dans bien d’autres documents d’orientation et programmes.
18. Comme on l’a vu dans la section précédente, la Division de statistique des Nations Unies a beaucoup fait pour mettre en oeuvre les recommandations du Programme d’action mondial sur le suivi et l’évaluation (A/37/351/Add.1 et Add.1/Corr.1, par.198) pour ce qui a trait à la mise au point de statistiques et à la collecte de données sur l’incapacité [22] . Ces activités se sont inspirées au niveau international du travail de l’Organisation mondiale de la santé sur la terminologie de l’incapacité et, en particulier, de la Classification internationale des handicaps, déficiences, incapacités et désavantages [23] établie par l’OMS et de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIH-2) [24] qu’elle vient d’adopter. Le résultat du travail des Nations Unies sur les statistiques concernant l’incapacité a été publié dans le Recueil de statistiques sur les incapacités [25] , et des améliorations et ajouts récents à la base de données paraissent sur l’Internet <http://unstats.un.org/unsd/disability/>.
19. Toutefois, 20 ans après l’adoption du Programme d’action mondial, il n’est toujours pas possible d’indiquer avec précision le pourcentage de la population souffrant d’un handicap. La raison en est qu’on continue d’observer des variations dans les données sur l’incapacité collectées par les Nations Unies, lesquelles résultent des différences entre les définitions, les concepts et les méthodes utilisées selon les pays. Les analystes ne peuvent ni établir de comparaison sur la nature et l’ampleur de l’incapacité au sein des pays ou entre eux, ni faire de comparaisons économiques et sociales entre les handicapés et le reste de la population. Selon la logique adoptée par l’OMS dans sa Classification internationale, le Recueil de 1990 distinguait entre les pays qui collectaient les données en se fondant sur l’incapacité et ceux qui se fondaient sur la déficience. Les derniers collectaient des données sur les aveugles, les sourds, les muets ou les sourds et muets et sur les incapacités physiques tandis que les premiers les recueillaient par grande catégorie d’incapacité, par exemple la motricité, l’agilité, la vue, l’ouïe, la parole ou autre (aptitude limitée due à un problème émotionnel, psychiatrique ou de développement) [26] . Certains pays incluaient des informations sur les personnes atteintes de handicaps mentaux ainsi que sur les malades – selon la logique causale de l’incapacité découlant d’une maladie ou d’un traumatisme adoptée dans la classification de l’OMS. Les différents critères de sélection utilisés pour obtenir les données concernant l’incapacité ont entraîné des erreurs importantes dans les estimations du pourcentage de handicapés par rapport au reste de la population totale dans les études par sexe, dans les comparaisons des caractéristiques économiques et sociales et dans l’activité économique [27] . Les lacunes de ces données, qu’elles soient dues à des erreurs de définition, de collecte ou d’estimation, gênent les efforts accomplis pour intégrer la question de l’incapacité aux actions envisagées à tous les niveaux. Cette question bénéficie d’un appui limité parce que les spécialistes de l’incapacité et les défenseurs des handicapés sont contraints, étant donné l’insuffisance des données ou leur absence, de participer au débat sans pouvoir décrire avec précision ce qui différencie les handicapés du reste de la population [28] . L’élaboration de politiques et de stratégies éclairées propres à accroître les possibilités économiques et sociales qui s’offrent aux handicapés exige des données exactes.
20. Des efforts ont été engagés sur le plan international pour répondre aux problèmes urgents auxquels se heurte la collecte des données sur l’invalidité, à savoir l’absence de définitions concertées de l’invalidité et l’absence de règles uniformisées pour la collecte des données. C’est ainsi que, dans le cadre des préparatifs du cycle de recensement de la population et de l’habitat de 2000, l’ONU a élaboré une version révisée de ses recommandations sur le recensement [29] , dans lesquelles elle a préconisé, pour la première fois, de rendre compte de la question de l’invalidité dans les recensements et les enquêtes au plan national. Aux fins de l’évaluation des incapacités, l’ONU recommande qu’une personne souffrant d’incapacité soit définie comme une personne dont les activités sont limitées en genre et en nombre du fait de difficultés de longue date, d’origine physique ou mentale ou tenant à son état de santé; par ailleurs, seules les incapacités d’une durée supérieure à six mois devraient être prises en compte [30] . Étant donné le manque de place dans un questionnaire de recensement, l’ONU a également proposé que la question posée porte sur l’incapacité plutôt que sur une déficience ou un handicap.
21. La plupart des débats concernant l’amélioration des statistiques sur l’invalidité mettent l’accent sur les définitions retenues dans la Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages, de l’OMS. Or, avec la notion de nouvel univers des incapacités, la nécessité apparaît de mesurer les secteurs de l’existence qui sont essentiels à l’égalisation des chances. On chercherait ainsi à déterminer si les handicapés sont en mesure de prendre eux-mêmes leurs décisions au cours de leur vie, sont maîtres de leur temps, disposent de ressources économiques et sont préparés à faire face aux changements importants qui peuvent survenir dans leur existence. Les résultats obtenus dans ces domaines sont souvent ce qui permet de dire si les objectifs visés en matière d’égalisation des chances sont atteints. Parce que la situation de chaque individu est unique et soumise à des facteurs multiples tels que l’âge, la culture ou l’endroit où l’on vit, il importe que soient compris les facteurs spécifiques qui touchent chaque personne handicapée dans son milieu de vie. Si l’on ne tient pas compte de ces interactions dans l’évaluation du handicap, on risque de perdre de vue des aspects essentiels des obstacles qui empêchent de remédier aux situations de désavantage.
22. Les définitions se rapportant au handicap soulèvent des difficultés croissantes sur le plan méthodologique du fait qu’elles risquent d’être confondues avec les secteurs cibles pour la participation dans l’égalité définis dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés. Il existe d’après certains analystes deux manières principales d’aborder l’évaluation du handicap: a) l’estimation des disparités entre les handicapés et les personnes valides; b) l’estimation des secteurs précis où les rôles de vie sont diminués [31] . Comme on l’a vu précédemment, les variables du milieu de vie peuvent avoir une incidence sur ces deux dimensions du problème, et dès lors favoriser ou empêcher la réalisation des objectifs du Programme d’action mondial, de sorte que toutes les dimensions doivent être prises en considération pour mesurer les progrès de l’émancipation des handicapés et les obstacles qui restent à surmonter. Une évaluation adéquate des dimensions liées au milieu de vie, du point de vue non pas des aptitudes de l’individu, mais des circonstances réelles dans lesquelles il se trouve et qui font qu’il peut être désavantagé, est susceptible de fournir des critères décisifs pour la conception de politiques et de programmes axées sur des secteurs précis de l’existence qui produisent le maximum d’impact sur l’égalisation des chances.
23. Les rapports sur l’application du Programme d’action mondial que le Secrétaire général a présentés à l’Assemblée générale à ses cinquante-quatrième (A/54/388 et Add.1) et cinquante-sixième sessions (A/56/169 et Corr.1) ont spécialement mis l’accent sur le rôle des progrès techniques et sur la promotion d’un milieu physique accessible à tous. Ils ont appelé l’attention sur les orientations de politique générale qui peuvent être tirées de la règle 5 pour l’égalisation des chances des handicapés, qui traite de l’accessibilité tant au milieu physique qu’aux technologies de l’information et des communications. Ils ont également présenté une proposition intéressante sur l’accessibilité du milieu physique qui envisage les «meilleures solutions totales» pour les initiatives à prendre par, pour et avec les handicapés dans le domaine de l’accessibilité au milieu physique (A/54/388/Add.1, par.2).
24. L’accessibilité du milieu physique concerne tout un chacun. Elle
est apparue comme une question majeure à mesure que l’on est passé d’une
conception médicale de l’invalidité qui mettait l’accent sur les soins, la
protection et l’aide permettant aux handicapés de s’adapter à des
structures sociales «normales», à une conception sociale et centrée sur le
développement qui privilégie l’autonomisation, la participation et la
transformation du milieu physique en vue de promouvoir l’égalisation des
chances pour tous. Les progrès techniques touchant le milieu physique sont
attestés par la gamme élargie d’équipements favorisant l’accessibilité
pour tous de par leur facilité d’emploi, leur durabilité et leur
ergonomie. Également importante a été la contribution de pays qui ont
publié sur l’Internet des directives pour la planification et la
conception de milieux physiques accessibles en vue de sensibiliser le
public et de faciliter la formation des agents nationaux; on peut citer
parmi ces pays le Liban (pour Beyrouth):
<http://www.un.org/esa/socdev/enable/
designm/>; Malte: <http://www.knpd.org/xsguidelines/xsgl.htm>; et le
Pérou: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/guiadd> [32] .
25. La rapidité avec laquelle évoluent les technologies de l’information et des communications a des conséquences sociales et économiques importantes pour les pays; elle peut aussi avoir une incidence sur la participation des handicapés à la vie sociale et au développement sur la base de l’égalité. Le rôle des technologies de l’information et des communications dans le contexte du développement d’une économie mondiale à forte intensité de connaissances au XXIe siècle a constitué le thème du débat de haut niveau de la session de fond de 2000 du Conseil économique et social, qui a adopté une Déclaration ministérielle sur le rôle des technologies de l’information et le développement [33] . La Déclaration note que les perspectives de pouvoir remédier à la fracture numérique, créer des possibilités d’accès à l’information et mettre en place des économies à forte intensité de connaissances reposent en grande partie sur l’éducation, les capacités nationales de production et d’utilisation des connaissances, les réseaux et les contenus informatiques, les politiques menées et le cadre juridique et réglementaire. S’il est plusieurs fois fait référence au «clivage numérique» et à l’importance de l’accès aux technologies de l’information et des communications pour atteindre les objectifs sociaux et économiques, il n’est pas fait mention de la situation des handicapés, et la Déclaration ne contient pas de recommandations techniques ou normatives sur les options de politique générale susceptibles de promouvoir des technologies de l’information et des communications accessibles à tous.
26. L’expérience récente des pays indique que deux points importants sont à retenir pour l’élaboration d’options de politique générale prenant en considération les problèmes des handicapés concernant l’accessibilité aux technologies de l’information et des communications: premièrement, l’accès à ces technologies n’est pas la même chose que leur accessibilité pour tous; deuxièmement, l’expression «clivage numérique» renvoie à l’ensemble des capacités de connexion numérique au niveau national et non à une situation particulière que connaîtraient les pays. L’accès aux technologies de l’information et des communications concerne en premier lieu les infrastructures de matériel et de télécommunications, tandis que l’accessibilité renvoie aux paramètres de conception et à la capacité des technologies à répondre aux besoins, préférences et aptitudes particulières de chaque utilisateur. Elle se préoccupe du contexte d’implantation des technologies de l’information et des communications, qui comprend la politique générale et le cadre juridique, le niveau de développement, les dispositions institutionnelles, les capacités nationales en matière de planification et de gestion des technologies de l’information et des communications et de production d’informations numériques, et l’état des infrastructures existant pour ces technologies et les technologies connexes.
27. L’accessibilité est l’une des questions prioritaires retenues par la première session du Comité spécial sur la question d’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés créé en application de la résolution 56/168 (New York, 29 juillet-9 août 2002). Dans le projet de résolution sur ses travaux futurs qu’il a soumis à l’Assemblée pour adoption à sa cinquante-septième session, le Comité spécial souligne expressément le rôle de technologies de l’information et des communications accessibles et «recommande vivement au Secrétaire général de prendre (...) des mesures visant à faciliter l’accès aux locaux du Siège de l’Organisation des Nations Unies, à la technologie et aux documents», en invitant, entre autres, les handicapés et les experts à faire des propositions à cet égard [34] .
28. Dans le rapport qu’il a présenté à l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session, le Secrétaire général cite la recherche médicale parmi les nouvelles questions qui pourraient être abordées lors du quatrième cycle d’examen et d’évaluation du Programme d’action mondial. Les progrès dans les domaines de la recherche médicale, de la génétique et des biotechnologies, en particulier, ont des conséquences importantes pour les handicapés et du point de vue de la confidentialité, de l’éthique et des droits de l’homme. Les progrès de la recherche génétique, depuis la description de la structure de l’ADN (acide désoxyribonucléique) il y a près d’un demi-siècle jusqu’aux prolongements récents du Projet sur le génome humain [35] , ont permis de mieux comprendre les bases génétiques de nombreuses maladies. Ces nouvelles connaissances ont de nombreuses applications dans le domaine médical, qui vont du dépistage et de la détection précoce de la vulnérabilité aux maladies, à l’évaluation des réponses médicamenteuses, en passant par les techniques qui permettraient de guérir certaines maladies (thérapie génique). D’aucuns estiment que l’apport des connaissances génétiques, ajouté au coût réduit des examens et tests génétiques, a été exagéré et soulève des problèmes d’ordre social et éthique. Inclusion International, organisation non gouvernementale menant une action en faveur des handicapés mentaux, a estimé que si la recherche génétique peut être bénéfique, elle risque aussi de porter atteinte aux droits de l’homme, notamment dans le cas des handicapés [36] . Les progrès dans le domaine des biotechnologies, notamment la thérapie cellulaire, le clonage reproductif et la manipulation chromosomique, sont porteurs de grandes promesses, mais ces techniques soulèvent aussi des questions éthiques et biomédicales complexes auxquelles les législations et les politiques actuelles ne permettent plus toujours de faire face [37] . Certains analystes ont défini un ensemble de principes qu’ils pensent devoir orienter les travaux futurs dans les domaines de la recherche génétique et de la biomédecine, à savoir la justice, l’absence de discrimination, la diversité et l’autonomie fondée sur la liberté de décision. Le principe de justice consiste en ce que toute personne a le droit de s’épanouir en fonction de son potentiel. Le principe de non-discrimination reconnaît à tout un chacun le droit au respect pour ce qu’il est et le droit de vivre sur un pied d’égalité avec ses concitoyens. Le principe de la diversité consiste à dire que le monde appartient à tous et pas seulement à ceux qui répondent à une certaine idée de la perfection ou de la normalité. Le principe de l’autonomie affirme que les personnes ont le droit d’être indépendantes et de prendre les décisions qui les concernent [38] .
29. Le renforcement des capacités pour l’égalisation des chances bénéficie de l’appui du système des Nations Unies dans un nombre limité de domaines sectoriels, en particulier l’aide et les services sociaux, la rééducation fonctionnelle et la protection sociale. C’est lorsqu’il a noté dans son premier rapport de suivi (A/52/56, annexe) que les efforts en vue d’intégrer l’action en faveur des handicapés dans les principales activités de coopération technique étaient demeurés limités au cours de son premier mandat (1994-1997) que le Rapporteur spécial sur la situation des handicapés a de nouveau appelé l’attention sur le renforcement des capacités dans le domaine du handicap. Il a noté:
«... Il est très probable que les programmes de développement lancés dans le cadre du suivi [des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies] feront encore une fois l’impasse sur les mesures en faveur des handicapés ou les relègueront au second plan. Il serait par exemple dommage que les programmes de lutte contre la pauvreté ne comportent pas de mesure d’aide aux handicapés. Il faut de toute urgence renforcer les mesures en faveur des handicapés et les intégrer dans les activités de coopération technique, notamment dans celles du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et d’autres institutions financières pour pouvoir appliquer les Règles.» (A/52/56, annexe, par.135)
30. Les initiatives visant à remédier aux problèmes rencontrés en matière de renforcement des capacités pour l’égalisation des chances sont, de manière générale, financées grâce à des fonds spéciaux tels que le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les handicapés, dont les maigres ressources ont été complétées, pour différents projets, par celles du Programme arabe du Golfe pour les organismes de développement des Nations Unies [39] . Dans son rapport à la cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale sur la mise en oeuvre du Programme d’action mondial (A/54/388/Add.1), le Secrétaire général a décrit l’appui apporté à des mesures catalytiques et novatrices visant à donner suite aux recommandations en matière de renforcement des capacités figurant dans la résolution 52/82 de l’Assemblée générale (par.8) en tant que question d’ordre général et les incidences de ces mesures pour l’égalisation des chances dans les domaines prioritaires que sont l’accessibilité, les services sociaux, les filets de sécurité, l’emploi et les moyens de subsistance durables. Il a été noté dans le rapport que la stratégie de renforcement des capacités était triple: a)privilégier les initiatives novatrices prises par les groupes de population intéressés, en collaboration avec les gouvernements, qui visent à remédier à un aspect spécifique de la situation des handicapés et ont un effet catalyseur; b) coopérer avec les agents de projet afin de formuler et de mettre en oeuvre des propositions d’actions opérationnelles, assorties de délais et conformes aux priorités identifiées pour mieux égaliser les chances; et c)documenter les enseignements tirés de l’expérience – et les obstacles rencontrés – à l’intention des autres intéressés, et les publier sur Internet pour en faciliter l’accès universel. Il a également été indiqué dans le rapport qu’il était possible de tirer trois leçons de l’appui apporté par le Fonds de contributions volontaires à un renforcement des capacités tenant compte de la situation des handicapés: a) les directives concises et stratégiques données par les gouvernements sur les priorités et moyens d’exécution nécessaires au renforcement des capacités nationales jouent un rôle essentiel; b)les partenariats établis à tous les niveaux pour faciliter les consultations, la coordination et l’exécution revêtent une importance critique; et c)il importe d’apporter des réponses rapides et appropriées en termes d’assistance technique et financière à petite échelle afin de faciliter le décaissement rapide du capital d’amorçage [40] . L’expérience du Fonds de contributions volontaires indique que, comme les politiques qui prennent en considération la situation des handicapés créent un cadre propice à un développement durable pour tous, les investissements d’ordre général dans le renforcement des capacités nationales et des institutions de la société civile en vue de l’égalisation des chances et de l’accessibilité du milieu font partie de ce que l’on peut décrire comme étant la prochaine génération de meilleures pratiques en matière de coopération technique du système des Nations Unies, essentielles à la réalisation de l’objectif défini dans la résolution 48/99 de l’Assemblée générale en date du 20décembre 1993, qui est de parvenir à une «société pour tous» d’ici à 2010.
31. Les principes généraux concernant les activités de coopération technique et les handicapés figurent dans le Programme mondial d’action concernant les personnes handicapées. La coopération technique est l’une des activités internationales identifiée dans le Programme pour atteindre l’objectif de la pleine participation des handicapés à la vie sociale et au développement et parvenir à l’égalité [41] . La coopération technique et économique fait également partie de la série de mesures de mise en oeuvre présentées dans les Règles, à savoir la Règle 21 (Coopération technique et économique) [42] . L’initiative présentée par le Mexique à l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session visant à élaborer une convention globale et intégrée sur les droits des personnes handicapées dans le cadre du développement n’a fait que mettre encore davantage l’accent sur le fait que le renforcement des capacités en vue de l’égalisation des chances était un élément essentiel des activités de coopération en faveur du développement, notamment de l’examen triennal des activités opérationnelles de développement [43] auquel procède l’Assemblée générale et des directives de programmation des fonds et programmes des Nations Unies. Il n’est actuellement pas tenu compte des handicapés lors de l’élaboration du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement ou des bilans communs de pays, qui ont obligatoirement des incidences sur la manière dont les ressources nécessaires au renforcement des capacités nationales pour l’égalisation des chances sont affectées.
32. Les activités de coopération technique font partie des initiatives de développement plus vastes qu’adoptent et mettent en oeuvre les gouvernements conformément à leurs politiques et priorités nationales. La coopération technique, par définition, débouche sur un produit intermédiaire dont les objectifs sont notamment de renforcer et d’améliorer les capacités et les institutions nationales aux fins d’un développement autonome. On ne peut juger du succès d’une activité de coopération technique qu’à l’aune de l’efficacité et de la durabilité de son suivi et de sa transposition dans d’autres domaines et secteurs, sur la base de l’égalité. Pour mieux tenir compte de la situation des handicapés dans les activités de coopération technique générales, il conviendra de prendre des mesures à plusieurs niveaux: des décisions politiques à l’échelon des gouvernements; des décisions de procédure en matière d’harmonisation et de simplification à celui des organismes des Nations Unies qui sont concernés; et des initiatives permettant une véritable participation des personnes handicapées en tant qu’agents et bénéficiaires du développement. Tout cadre stratégique visant à ce qu’il soit davantage tenu compte des handicapés dans les activités de coopération technique générales devrait se fonder sur les éléments ci-après:
a) Aspects décisionnels. Les objectifs définis pour mieux prendre en compte la situation des handicapés dans les activités de coopération technique doivent se rattacher clairement aux objectifs et priorités établis par les gouvernements en matière de développement et notamment à la suite donnée aux grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies. Les objectifs faisant tout particulièrement référence aux handicapés devraient faire partie intégrante des objectifs de développement et non pas être présentés comme jouant un rôle complémentaire. Il conviendrait d’aborder de façon objective la question des incidences sur les ressources d’objectifs visant un groupe social spécifique plutôt que les avantages d’approches générales. Le suivi durable et la transposition des activités de coopération technique demandent de la part des gouvernements un engagement total; il importe que les décisions prises soient cohérentes et aillent dans le sens des politiques et priorités des pays en matière de développement;
b) Participation. La pleine participation et l’égalité sont les objectifs adoptés par la communauté internationale pour le Programme mondial d’action concernant les personnes handicapées. La participation des handicapés à la prise des décisions qui ont des incidences sur leurs moyens de subsistance et leur bien-être fait partie intégrante de l’ensemble des droits de l’homme nécessaires au développement. Il s’agit là de permettre aux handicapés de contribuer au processus de prise de décisions en matière de développement et aux efforts menés en faveur du développement et de bénéficier, sur un pied d’égalité, des avantages en résultant. Les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies ont permis d’aborder la situation des handicapés en ce qui concerne un grand nombre de questions de fond et pas seulement de problèmes spécifiquement liés au handicap. Grâce à l’initiative prise par le Mexique à la cinquante-sixième session de l’Assemblée générale visant à élaborer une convention globale et intégrée sur les droits des personnes handicapées, on considère désormais que le respect des droits de l’homme de ces dernières est un élément indispensable à la promotion des droits de tous;
c) Institutions. La coopération technique, si l’on veut qu’elle porte ses fruits, requiert l’existence de mécanismes institutionnels à plusieurs niveaux chargés d’en planifier, d’en organiser et d’en fournir des éléments, et d’en faire profiter les groupes cibles, avec leur aide. La coopération technique faisant souvent intervenir de nouveaux concepts, méthodes, technologies et procédures, il importe que les organisations locales, notamment les organisations de personnes handicapées, participent à tous les aspects de la planification, de la conception et de la mise en oeuvre des activités menées en la matière et de leur suivi. Cette participation permet aux parties prenantes de jouer un rôle plus important et de s’assurer que les activités de coopération technique sont adaptées aux besoins locaux, à la situation socioculturelle et aux capacités techniques, administratives et financières existantes;
d) Ressources. Bien que les ressources fournies au niveau local puissent faciliter de manière non négligeable les activités de coopération technique, il convient d’être conscient que la majorité des handicapés vivant dans les pays en développement et les pays en transition sont pauvres et habitent principalement des zones rurales. Nombre d’entre eux ne pouvant contribuer à ces activités, par des ressources matérielles ou en nature, que de façon limitée, les politiques et plans adoptés doivent tenir dûment compte des incidences en matière de revenus et d’emploi pour les groupes cibles et de la façon dont les coûts de mise en oeuvre et de suivi des projets sont répartis;
e) Renforcement des capacités. Pour que les activités de coopération technique générales contribuent à améliorer la participation fondée sur l’égalité des personnes handicapées en tant qu’agents et bénéficiaires du développement, il importe de systématiquement renforcer les institutions et les capacités, notamment 1) celles du personnel des programmes et organismes de coopération technique concernés (au niveau de la planification et de la gestion); 2)celles des agents sur le terrain (au niveau de la mise en oeuvre); et 3)celles des personnes handicapées (les bénéficiaires);
f) Suivi et évaluation. Le suivi et l’évaluation des activités opérationnelles de développement est un souci majeur du système des Nations Unies, en particulier pour ce qui est de la simplification et de l’harmonisation des procédures et d’une diffusion plus efficace et plus rapide des enseignements tirés des opérations menées à cet égard en vue d’obtenir de meilleurs résultats et de renforcer les capacités nationales [44] . L’un des moyens susceptibles d’améliorer les procédures de suivi et d’évaluation serait d’introduire des points de décision tenant dûment compte de la situation des handicapés dans une nouvelle version du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. Le renforcement des aspects liés à la situation des personnes handicapées dans les activités de coopération technique reviendrait à prendre en compte trois éléments lors des évaluations rétrospectives: 1)la façon dont les handicapés participent à la prise de décisions en matière de planification, de conception et d’exécution des activités de coopération technique générales; 2)les avantages que tirent les handicapés de la coopération technique; la façon dont ces avantages sont répartis; les coûts qui sont associés aux activités et les entités qui supportent ces coûts; et les résultats des projets s’agissant de la situation des handicapés; 3) la suite – éventuelle – donnée aux projets, les entités ayant participé à la prise de décisions et la façon dont l’expérience a pu être utilisée pour d’autres bénéficiaires, secteurs et zones géographiques.
[1] Rodrigo Jiménez Sandoval, Eliminando Barreras, Construyendo Oportunidades (Nations Unies, Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, San José (Costa Rica), 1977) <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dislteq1.htm>.
[3] See Hahn, Harlan, «The political implications of disability definitions and data», Disability Policy Studies, vol. 4, No. 2.
[5] Rioux, Marcia H., «Disability: the place of judgement in a world of fact», Journal of Intellectual Disability Research, vol. 41, No. 2.
[6] Oliver, Michael, «Changing the social relations of research production», Disability, Handicap and Society, vol. 7, No. 2.
[7] Brown, Scott Campbell, «Methodological paradigms that shape disability research», in Gary L. Albrecht, Katharine D. Seelman and Michael Bury, eds., Handbook of Disability Studies (Thousand Oaks, Sage Publications, 2001).
[8] Pechansky, R., and C. Thomas, «The concept of access: definition and relation to customer satisfaction», Medical Care, vol. 19, No. 2.
[10] Whiteneck, Gale G., Patrick Fougeyrollas and Kenneth A. Gerhart, «Elaborating the model of disablement», in Marcus J. Fuher, ed., Assessing Medical Rehabilitation Practices: the Promise of Outcomes Research (Baltimore, Paul H. Brookes Publishing, 1997).
[11] Ron Mace http://www.design.ncsu.edu/cud/univ_design/ud.htm.
[12] World Health Organization, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (Geneva, 1980).
[13] Report of a consultative expert meeting on critical issues and trends related to disability and human rights: emerging issues and concepts, York University, Toronto, 17-19 June 2002.
[15] Robert L. Metts, «Planning for disability», exposé présenté lors d’un débat sur l’autonomie des handicapés, Organisation des Nations Unies, 3 décembre 1998 <http://www.un.org/esa/socdev/enable/disid98f.htm>.
[16] Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément No 6 (E/1998/26) chap.I, par. 38 à 63.
[17] Débats de la première Conférence mondiale; Disabled People’s International (Singapour, 30novembre-4décembre 1981) <http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/DPI/ DPI81.pdf>.
[18] Nations Unies. Guidelines and principles for the development of disability statistics (2001), p.2 à 9.
[19] La Classification ne tient pas compte non plus du fait que le désavantage peut entraîner une invalidité ou une déficience.
[20] Le terme «acquisition» est utilisé dans le sens que lui donne M.Amartya Sen dans son analyse des droits et avantages et des capacités. Pour M.Sen «En fin de compte, le développement économique doit prendre en considération ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire, par exemple, lire, écrire et communiquer, prendre part à des activités littéraires ou scientifiques». Toujours pour M.Sen «L’un des grands défauts de l’économie ... classique, est qu’elle a tendance à privilégier l’offre de biens aux dépens de l’appropriation et des droits». Les droits et avantages, dans ce sens, «renvoient à tous les autres biens qu’un individu peut obtenir dans la société, en utilisant dans leur totalité les droits et les possibilités qui s’offrent à lui.» Sur la base de ces droits et avantages, «une personne peut acquérir certaines capacités (par exemple celle d’être bien nourrie) et ne pas réussir à en acquérir d’autres». Voir Amartya Sen, «Development: which way now?», The Economic Journal, vol.93 (1983), p.745 à 762. Le développement en vient donc à être conçu comme un élargissement de ce à quoi tous ont droit.
[21] Seelman, Katherine D. Change and challenge: the integration of the new paradigm of disability into research and practice; Vision for the 21st century: population, health care, technology and employment, exposé présenté à la Conférence du National council on rehabilitation education (Vancouver), 8 mars 1998.
[22] Il y a lieu de relever le travail effectué par plusieurs organismes sur les statistiques et indicateurs, dont l’OIT (emploi), l’UNESCO (éducation), l’OMS (santé) et l’UNICEF (enfant et survie de l’enfant); les commissions régionales des Nations Unies mettent elles aussi en oeuvre de grands programmes statistiques.
[23] Classification internationale des handicaps, déficiences, incapacités et désavantages, op. cit.
[25] Statistiques relatives à certains groupes de population (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.90.XVII.17).
[26] La Division de statistique des Nations Unies a également constaté que l’approche fondée sur les handicaps conduisait à des taux d’incapacité plus élevés que celle fondée sur les déficiences. Une seule question visant à évaluer le déficit fonctionnel associé à une incapacité englobe le comportement associé à une vaste gamme de déficiences. La difficulté à monter les escaliers, par exemple, peut être due à plusieurs déficiences. En revanche, l’approche fondée sur les déficiences utilise en général des questions plus précises qui ont trait à un état précis; ainsi une question sur «la perte d’audition» permet de déterminer si cette perte est importante et concerne une oreille ou les deux.
[27] La Division de statistique des Nations Unies a appelé l’attention sur la nécessité de normaliser les méthodes de calcul des taux d’incapacité; ainsi, le taux brut d’incapacité ou de déficience devrait par définition avoir pour numérateur tous les handicapés dans la population totale, et pour dénominateur le nombre total de la population; les taux d’incapacité par groupe d’âge doivent avoir des numérateurs et dénominateurs portant sur des groupes d’âge type comparables.
[28] Metts, Robert L., An overview of future research in disability and development, document non publié (2002).
[29] Principes et recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat, Première révision. Études statistiques, Série M, No67/Rev.1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.98.XVII.8).
[31] Mary Chamie, 1992, «A perspective for considering the classification of Handicap» (article non publié); Scott Campbell Brown (1993), «Revitalizing ‘handicap’ for disability research», Journal of Disability Studies, vol. 4, No2).
[32] Dans le contexte de l’objectif de la Décennie Asie-Pacifique pour les handicapés (1993-2002) consistant à promouvoir l’accessibilité au milieu physique pour tous, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a entrepris, avec l’appui financier et technique du Gouvernement japonais (Ministère des travaux publics en particulier), un projet régional visant à promouvoir un milieu physique adapté pour les handicapés et les personnes âgées. La CESAP a publié des directives sur le sujet (ST/ESCAP/1492) et des études de cas sur l’expérience acquise par certains pays dans ce domaine (ST/ESCAP/1510). Elle a organisé des ateliers de formation à Beijing et à New Delhi; à Bangalore (Inde), Pattaya (Inde) et Penang (Malaisie), elle a expérimenté sur le terrain un ensemble de directives à l’usage des formateurs. <http://www.unescap.org/decade/nhe.htm>.
[33] Conseil économique et social, document E/2000/L.9.
[34] A/57/357, par. 16 <http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoca57357f.htm>.
[35] Human Genome Project Information, <http://www.ornl.gov/hgmis/>.
[36] Ligue internationale des associations d’aide aux handicapés mentaux (1994). Just Technology? From principles to practice in bio-ethical issues (Toronto, Roeher Institute).
[37] Kass, Leon R. (2002). Life, Liberty and the Defense of Dignity (San Francisco, Encounter Books).
[38] Avard, Denise (2002), «New genetics» (article non publié).
[39] <http://www.agfund.org/>.
[40] Document A/54/388/Add.1 sur la coopération en faveur du développement tenant compte de la situation des handicapés au XXIesiècle: partenariats et capital d’amorçage.
[41] Document A/37/351/Add.1 et Add.1/Corr.1.
[42] Résolution 48/96 de l’Assemblée générale en date du 20décembre 1993, annexe, règle 21.
[43] «Examen triennal des activités opérationnelles de développement des Nations Unies». La résolution 56/201 de l’Assemblée générale en date du 21décembre 2001 appelle spécialement l’attention sur la mondialisation, l’aide humanitaire, les sexospécificités, le financement des activités opérationnelles de développement et la simplification et l’harmonisation des procédures.