 |
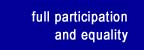 |
|
 |
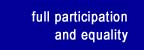 |
|
Droits fondamentaux des personnes handicapéesConseil Économique et Social COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME RAPPORT DE LA HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME ET SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L’HOMMENote du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 1. Dans sa résolution 2000/51, la Commission des droits de l’homme a invité la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en coopération avec le Rapporteur spécial de la Commission du développement social chargé de la question de l’invalidité, à examiner les mesures qui permettraient de renforcer la protection et le suivi des droits fondamentaux des handicapés et à solliciter la contribution et les propositions des parties intéressées. 2. Comme suite à la résolution de la Commission des droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a décidé d’amplifier ses activités relatives à l’invalidité. Il a intensifié sa collaboration avec le Rapporteur spécial chargé de la question de l’invalidité et a décidé de faire une plus large place à la question de l’invalidité, de deux manières: en encourageant les entités mises en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, parmi lesquels les rapporteurs spéciaux et les organes créés en vertu d’instruments internationaux, à s’intéresser davantage aux droits des personnes souffrant d’un handicap en incitant les organisations non gouvernementales (ONG) s’occupant des problèmes liés au handicap à développer leurs échanges avec le dispositif de protection des droits de l’homme. Le premier résultat du projet conçu par le Haut-Commissariat à cette fin a été l’élaboration et la publication d’une étude où sont évalués les normes et les rouages existants en matière de droits de l’homme et d’invalidité. 3. L’étude visait un triple but: a) Servir d’ouvrage de référence sur les droits de l’homme et l’invalidité; b) Examiner l’utilité pratique et le fonctionnement du système mis en place par les Nations Unies en matière de droits de l’homme sous l’angle de l’invalidité. L’étude analyse les dispositions des six principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et la manière dont les organes de suivi de ces instruments ont abordé la question et elle donne un aperçu du rôle joué par le réseau des institutions nationales chargées de la protection des droits de l’homme et par la société civile; c) Proposer des orientations futures aussi bien pour améliorer l’utilisation des normes et des rouages existants en matière de droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité que pour étudier la nécessité éventuelle d’un nouvel instrument international. 4. Les conclusions provisoires de l’étude, qui avait été commandée au Research Centre on Human Rights and Disability de l’Université de Galway (Irlande), ont été présentées lors d’une réunion à Genève, le 14 janvier 2002, par M. Gerard Quinn et Mme Theresia Degener, les deux auteurs principaux. La réunion a été accueillie par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme et le Rapporteur spécial chargé de la question de l’invalidité y a participé. Plus de 30 États étaient représentés ainsi qu’un certain nombre d’ONG et d’organes et institutions des Nations Unies. 5. À cette occasion, il a aussi été procédé à un échange de vues sur la résolution 56/168 de l’Assemblée générale. Par cette résolution, l’Assemblée générale a créé un comité spécial, ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les observateurs, ayant pour tâche d’examiner des propositions en vue d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées en tenant compte de l’approche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, les droits de l’homme et de la non-discrimination et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social. Elle a en outre, invité le HCDH et le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat à apporter leur concours à cet égard et les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme à collaborer aux travaux confiés au Comité et à faire bénéficier ce dernier de leurs compétences. 6. Les participants à la réunion ont décidé qu’il fallait adopter une approche multiforme en matière d’invalidité. Ils se sont accordés à reconnaître que l’accent devait être mis sur la dimension droits de l’homme des questions à prendre en compte. Les conclusions provisoires de l’étude soulignent que l’élaboration d’une nouvelle convention ne devrait pas empêcher d’attacher une importance accrue à l’invalidité dans le cadre du dispositif international existant en matière de droits de l’homme («stratégie à deux volets»). Les débats ont montré qu’il fallait poursuivre et intensifier les efforts de développement social dans le domaine de l’invalidité et intégrer plus efficacement les activités menées par l’Organisation des Nations Unies à cet égard en envisageant davantage la question dans l’optique des droits de l’homme («stratégie à volets multiples»). Nombre de participants ont aussi insisté sur la nécessité d’associer les ONG et les organisations s’occupant de l’invalidité au processus de consultation et d’élaboration du nouvel instrument. 7. Compte tenu de la résolution 2000/51 de la Commission et de la résolution 56/168 de l’Assemblée générale, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme présente ci-après pour information à la Commission un résumé des conclusions de l’étude sur les droits de l’homme et l’invalidité qui est en cours d’achèvement. ANNEXELes droits de l’homme pour tous: évaluation de l’utilisation actuelle des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et des possibilités qu’offrent ces instruments dans la perspective de l’invaliditéRésuméLa présente étude porte sur l’utilisation actuelle des instruments relatifs aux droits de l’homme et des possibilités qu’offrent ces instruments dans le domaine particulier de l’invalidité. Plus de 600 millions de personnes, soit 10 % environ de la population mondiale, souffrent d’une forme de handicap. Plus des deux tiers d’entre elles vivent dans des pays en développement. Dans le monde en développement, 2 % seulement des enfants handicapés reçoivent un enseignement ou font l’objet d’une réadaptation. La relation entre l’invalidité, d’une part, la pauvreté et l’exclusion sociale, d’autre part, est directe et durable partout dans le monde. Un changement radical s’est opéré au cours des deux dernières décennies dans la mesure où la stratégie adoptée à l’égard des handicapés a cessé d’être inspirée par la charité pour se fonder sur les droits de l’homme. Essentiellement, envisager l’invalidité dans l’optique des droits de l’homme revient à considérer les personnes souffrant d’un handicap comme des sujets et non plus comme des objets. Les personnes qui naguère apparaissaient comme autant de problèmes sont ainsi devenues des titulaires de droits. Fait important, désormais le problème se situe au dehors de la personne handicapée et, ce qui doit être examiné, c’est la manière dont les divers processus économiques et sociaux tiennent compte ou non, suivant le cas, de la différence due à l’invalidité. Le débat sur les droits des personnes handicapées doit donc être rattaché à un autre débat, plus général, qui porte sur la place faite à la différence dans la société. Il s’agit d’assurer aux personnes handicapées plutôt que la jouissance de droits spéciaux l’exercice effectif, en toute équité, de tous les droits de l’homme, sans discrimination. Le principe de la non-discrimination aide à prendre en compte les droits de l’homme en général dans la perspective particulière de l’invalidité, et à faire bénéficier les personnes handicapées du même régime que les personnes âgées, les femmes et les enfants. La non-discrimination et l’exercice effectif en toute équité des droits de l’homme par les personnes handicapées, tels sont donc les principaux ingrédients du changement d’attitude qui est depuis longtemps nécessaire dans le monde entier, à l’égard de l’invalidité et des personnes handicapées. Le processus tendant à assurer aux personnes handicapées la jouissance de leurs droits fondamentaux est lent et irrégulier mais il est en cours dans tous les systèmes économiques et sociaux. Il procède des valeurs qui sont le fondement des droits de l’homme: l’inestimable dignité de tout être humain, le principe de l’autonomie ou de la libre disposition de soi selon lequel la personne doit être au centre de toutes les décisions la concernant, l’égalité intrinsèque indépendamment des différences et la règle de la solidarité selon laquelle la liberté de la personne doit être assurée par des aides sociales appropriées. Cette évolution est officiellement approuvée au niveau de l’Organisation des Nations Unies depuis deux décennies. Rien ne saurait mieux l’illustrer que les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés que l’Assemblée générale a adoptées par sa résolution 48/96 du 20 décembre 1993. L’application de ces règles est suivie par un rapporteur spécial des Nations Unies, M. Bengt Lindqvis, qui a été chargé de cette tâche par la Commission du développement social. L’existence de telles règles et surtout le rôle joué par le Rapporteur spécial contribuent de façon décisive à sensibiliser l’opinion aux droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap et à favoriser une réorientation positive dans le monde entier. Les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme offrent de grandes possibilités dans ce domaine mais ont jusqu’ici, en règle générale, été insuffisamment utilisés aux fins de la promotion des droits des personnes souffrant d’un handicap. L’étude est centrée sur les six principaux instruments relatifs aux droits de l’homme: le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’idée centrale est que le processus de changement en faveur des personnes souffrant d’un handicap actuellement en cours dans le monde pourrait être considérablement renforcé et accéléré si ces instruments étaient utilisés davantage et de façon plus ciblée. Il convient de souligner qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer le respect des droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap. Autrement dit, le dispositif mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme ne peut être utilisé et n’a de valeur que si une réforme sérieuse est opérée au niveau national. Les instruments relatifs aux droits de l’homme n’ont pas simplement un caractère indicatif, ils imposent aux États parties l’obligation du changement. Les États parties s’orientent tangiblement vers une prise en compte de l’invalidité dans l’optique des droits de l’homme. Une étude récente montre que 39 États de toutes les régions du monde ont adopté des lois en faveur de la non-discrimination et de l’égalité des chances dans le contexte de l’invalidité. Le dialogue des États parties avec les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme a un effet bénéfique sur l’action entreprise en vue d’améliorer la situation des personnes souffrant d’un handicap; on compte désormais dans le monde un nombre appréciable de pratiques recommandables qui pourraient être utilement diffusées par le biais du régime conventionnel mis en place dans le domaine des droits de l’homme. Le changement d’orientation constaté trouve aussi son expression dans le fait que les institutions nationales chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme partout dans le monde ont commencé à s’intéresser de près à la question de l’invalidité. C’est important car ces institutions aident à jeter un pont entre le droit international relatif aux droits de l’homme et la réforme du droit et de la politique internes en matière d’invalidité qui est envisagée. Les institutions nationales sont des partenaires stratégiques pour mener à bien le processus et leur engagement croissant en faveur des droits fondamentaux des personnes handicapées est extrêmement prometteur pour l’avenir. Les personnes souffrant d’un handicap elles-mêmes expriment maintenant le sentiment d’injustice qu’elles ressentent depuis longtemps en termes de droit. Elles ne sont plus des victimes isolées. Les ONG qui s’occupent des questions relatives à l’invalidité, par exemple par le truchement du projet réalisé en collaboration «Disability Awareness in Action», commencent à se considérer aussi comme des ONG protégeant les droits de l’homme. Elles ont entrepris de recueillir et d’exploiter des informations précises sur des violations présumées des droits fondamentaux de personnes souffrant d’un handicap. Leurs capacités en matière de droits de l’homme, bien qu’elles soient encore relativement limitées, se développent. Un processus analogue de transformation est en cours au sein des ONG œuvrant en faveur des droits de l’homme de type traditionnel qui, de plus en plus, voient dans l’invalidité une question à inscrire dans le courant général des droits de l’homme. Ce n’est pas négligeable étant donné que ces ONG possèdent des structures extrêmement élaborées et l’instauration d’une synergie performante entre les ONG s’occupant de l’invalidité et les ONG œuvrant en faveur des droits de l’homme de type traditionnel n’est pas seulement nécessaire depuis longtemps, elle est aussi inévitable. Au total, le moment est venu d’évaluer la situation en ce qui concerne l’utilisation actuelle des instruments relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies et les possibilités qu’ils offrent dans la perspective de l’invalidité. Buts de l’étude L’étude vise trois buts principaux. Le premier est d’apporter des éclaircissements sur l’applicabilité des six instruments relatifs aux droits de l’homme à l’invalidité. À cette fin, les diverses obligations incombant aux États parties en vertu des instruments seront précisées et la manière dont les mécanismes pertinents de mise en œuvre fonctionnent dans la perspective de l’invalidité sera indiquée. Il est à espérer que l’étude constituera un ouvrage de référence utile pour tous les partenaires, à savoir les États parties, les organes de suivi de traités, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, les institutions nationales s’occupant des droits de l’homme et la société civile. L’étude ne prétend pas être exhaustive. Elle représente un progrès par rapport aux textes existants dans la mesure où elle démontre l’applicabilité de la protection des droits de l’homme assurée par les six instruments à l’invalidité. Une analyse plus poussée sera nécessaire lorsque le débat aura avancé. En deuxième lieu, l’étude vise à déterminer comment le dispositif fonctionne réellement dans la pratique pour ce qui est de l’invalidité en examinant le contenu des rapports présentés par les États parties aux organes de suivi des traités sur les droits de l’homme et l’invalidité et les réponses des organes de suivi des traités. Un total de 147 rapports périodiques a été passé en revue. La sélection a été effectuée en fonction de la documentation existante et de manière à assurer une répartition géographique raisonnable. Il ne s’agit pas de critiquer tel ou tel État partie mais simplement de se faire une idée de la vision qu’ont les États parties de l’exécution de leurs obligations dans la perspective particulière de l’invalidité. Il ne s’agit pas non plus de critiquer les organes de surveillance. Leur attention et leurs modestes ressources sont engagées dans bien des directions différentes et la valeur qu’ils attribuent désormais aux divers instruments relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de l’invalidité atteste qu’ils ont compris que l’invalidité relève des droits de l’homme. Notre analyse de l’évaluation contenue dans l’étude ne prétend pas être scientifique mais elle offre néanmoins une base suffisante pour en tirer des enseignements généraux - lesquels, si tout va bien, aideront à recentrer les problèmes liés au handicap plus durablement et plus précisément. Enfin le troisième - et principal - but de l’étude est de proposer des orientations futures. L’étude contient donc des observations, des commentaires et des recommandations sur la manière dont les différents partenaires pourraient améliorer l’utilisation des six instruments relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. Elle propose de renforcer le dispositif tout en préconisant l’adoption d’une convention thématique sur les droits des personnes souffrant d’un handicap. Pour diverses raisons, les auteurs arrivent à la conclusion qu’une telle convention est nécessaire et serait propre à étayer - et non fragiliser - les instruments existants en matière d’invalidité. Aperçu de l’étudeL’étude est divisée en trois parties. La partie I, intitulée «Du droit indicatif au droit contraignant», porte sur la nature de l’évolution en faveur d’une prise en compte de l’invalidité dans l’optique des droits de l’homme. Elle comprend trois chapitres. Le chapitre 1 traite de l’applicabilité des valeurs et de la doctrine des droits de l’homme à l’invalidité. Il affirme que le problème essentiel en matière d’invalidité est la relative invisibilité des personnes souffrant d’un handicap aussi bien dans la vie sociale qu’au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme existants. Il conclut que la principale difficulté est d’accepter la différence découlant de l’invalidité et d’attirer l’attention sur les personnes souffrant d’un handicap dans le régime conventionnel. Le chapitre 2 rappelle de façon succincte comment l’évolution intervenue a trouvé son expression officielle dans toute une série d’instruments adoptés dans le cadre du système des Nations Unies au cours des deux dernières décennies. Il prélude à un examen de la place accordée actuellement aux droits des personnes souffrant d’un handicap par le régime conventionnel mis sur pied par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Le chapitre 3 présente ce régime conventionnel et jette ainsi un pont entre le «droit indicatif» et le «droit contraignant». Un important principe mis en exergue par l’étude est qu’il est nécessaire de franchir ce pont pour utiliser pleinement les instruments relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. La partie II, intitulée «Examen de l’utilisation actuelle des instruments relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies - Principales constatations», est une analyse circonstanciée de l’importance réelle et potentielle de chacun des six instruments relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. Elle comprend six chapitres correspondant aux six instruments. Elle consiste d’une part en un exposé, d’autre part en une évaluation. L’exposé tend à mettre en lumière l’intérêt du contenu de ces instruments du point de vue de l’invalidité. Chacun des droits protégés est examiné et des éclaircissements sont apportés sur son applicabilité. L’évaluation est constituée d’une série de monographies concernant la manière dont les dispositions des différents instruments sont habituellement mises en œuvre dans le contexte de l’invalidité. Le chapitre 4 a trait à la liberté et à l’invalidité au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet instrument est étudié en premier parce que les principes éthiques essentiels du mouvement mondial en faveur des droits des personnes souffrant d’un handicap sont la liberté et la participation. En d’autres termes, ce que les personnes souffrant d’un handicap souhaitent le plus c’est d’avoir accès aux mêmes droits - et obligations civiques - que les autres. Le respect systématique des droits des handicapés découlant du Pacte non seulement protégerait des abus les personnes souffrant d’un handicap, mais aiderait puissamment à éliminer les obstacles à l’intégration. D’après les rapports examinés, nombre d’États continuent à considérer que l’invalidité relève de la protection sociale et non des droits conférés par le Pacte. Les auteurs de l’étude ont constaté que neuf plaintes relatives l’invalidité avaient été présentées au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte. La plupart ont été jugées irrecevables. Une plainte au moins a débouché sur une décision très utile qui a fait jurisprudence sur le traitement réservé aux prisonniers souffrant d’un handicap. En substance, le Comité a affirmé que les États parties ont l’obligation de répondre aux besoins des prisonniers ayant des besoins spéciaux. Une telle décision montre que le Comité se rend compte qu’il ne suffit pas de réserver le même traitement à toutes les personnes, mais qu’une prestation supplémentaire (ou un «arrangement raisonnable») peut être nécessaire pour rendre «réels» les droits des personnes souffrant d’un handicap. Cette interprétation positive est extrêmement prometteuse pour les personnes souffrant d’un handicap. Le chapitre 5 se rapporte à l’éthique de la justice sociale et de l’invalidité dans la perspective de l’invalidité. L’invalidité est l’un des domaines où peuvent le mieux être affirmées et démontrées l’indivisibilité et l’interdépendance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il est indispensable mais insuffisant de recourir au droit formel pour éliminer les obstacles à l’intégration. Il faut permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’accéder à la liberté mais aussi aux moyens d’en profiter. Un tel objectif peut être atteint par l’octroi d’aides sociales appropriées et, en particulier, par le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Ce chapitre a été placé après celui qui est consacré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour éviter que les droits prévus par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne soient considérés comme les plus importants dans le contexte de l’invalidité en raison de leur rapport évident avec l’aide sociale. Dans la remarquable Observation générale no 5 sur les personnes souffrant d’un handicap, qu’il a adoptée en 1994, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels estime que les droits énoncés dans le Pacte sont l’outil indispensable pour permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’avoir prise sur leur propre vie et pour leur assurer une aide permanente aux fins d’une participation active à la vie de la société. Ainsi, pour le Comité le droit à la santé (art. 12) est considéré comme directement lié à une telle participation. D’après les rapports examinés, les États parties, pour la plupart, ne font pas le rapprochement entre les droits énoncés dans le Pacte et la réalisation de l’indépendance, de l’autonomie et de la participation. L’Observation générale no 5 n’en marque pas moins une étape décisive et le Pacte, en principe, peut contribuer grandement à sensibiliser tous les partenaires au meilleur emploi possible des aides sociales et des droits appropriés en vue d’éliminer les obstacles et de permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’être associés à tous les aspects de la vie. Le sujet du chapitre 6 est l’importante question de la protection des personnes souffrant d’un handicap contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants en application de la Convention contre la torture. Cette question concerne particulièrement les millions de personnes souffrant d’un handicap qui vivent dans des institutions ou d’autres catégories d’établissements. L’invalidité aggrave le déséquilibre des forces dans beaucoup de ces lieux de vie et rend les personnes souffrant d’un handicap plus vulnérables aux mauvais traitements. Les problèmes liés à l’invalidité n’occupent pas une grande place dans la plupart des rapports périodiques examinés. Une plainte relative à la situation des prisonniers handicapés, qui a été soumise au Comité contre la torture, a été jugée irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Le chapitre 7 est consacré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans la mesure où elle est applicable aux femmes souffrant d’un handicap. L’Observation générale no 5 indique que les personnes souffrant d’un handicap sont parfois traitées comme des êtres humains asexués. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a lui-même adopté la Recommandation générale no 18 sur les femmes handicapées où il recommande aux États parties d’inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur la situation des femmes handicapées en ce qui concerne l’exercice de plusieurs droits énoncés dans la Convention. Dans les rapports périodiques examinés, on ne trouve guère d’informations sur la double discrimination dont peuvent être victimes les femmes souffrant d’un handicap. Le chapitre 8 a trait à la Convention relative aux droits de l’enfant dans la mesure où elle est applicable aux enfants souffrant d’un handicap. Cette Convention est la seule parmi les instruments relatifs aux droits de l’homme qui contienne un article particulier sur les enfants handicapés (art. 23). L’existence de cet article ne porte évidemment en rien atteinte à l’applicabilité générale de toutes les autres dispositions de la Convention aux enfants souffrant d’un handicap. Le Comité des droits de l’enfant est remarquablement vigilant en matière d’invalidité. En 1997, il a organisé une journée de débat général sur les enfants handicapés qui a eu une incidence très positive sur son approche de la situation des enfants souffrant d’un handicap. L’adoption par le Comité d’une stratégie concertée eu égard aux enfants souffrant d’un handicap semble être en bonne voie. Le chapitre 9 porte sur une autre sous-catégorie de personnes handicapées, à savoir les personnes handicapées appartenant à des minorités raciales ou autres. Si la discrimination dont ces personnes sont les victimes est sans doute en grande partie attribuable à leur race, la possibilité d’une double discrimination ne saurait être écartée. D’ailleurs, le phénomène de la double discrimination fondée sur la race et l’invalidité a été expressément reconnu à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Beaucoup d’États parties incluent déjà systématiquement des renseignements relatifs à la discrimination fondée sur l’invalidité dans leurs rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le plus souvent sous la forme de données de base concernant leurs lois générales contre la discrimination. Cette pratique est des plus utiles car elle offre au Comité la possibilité de dialoguer avec les États parties sur la question de la double discrimination. La partie III de l’étude ébauche des orientations pour l’avenir. Elle comprend quatre chapitres. Le chapitre 10 analyse les résultats d’un questionnaire détaillé qui a été envoyé aux ONG s’occupant de l’invalidité. Environ 80 réponses ont été reçues d’ONG internationales, d’ONG régionales et d’ONG nationales de toutes les parties du monde. Le taux de réponse a été satisfaisant étant donné le délai fixé. Il avait été décidé de s’adresser aux ONG s’occupant de l’invalidité et non aux ONG œuvrant en faveur des droits de l’homme de type traditionnel afin de savoir si et de quelle façon ces organisations considèrent l’invalidité comme une question relevant des droits de l’homme et de connaître leurs vues sur le régime conventionnel. L’examen des réponses montre la mesure dans laquelle les ONG s’occupant de l’invalidité ont elles-mêmes opté pour une optique fondée sur les droits de l’homme. Beaucoup ont déclaré qu’elles se considéraient d’abord comme des ONG œuvrant en faveur des droits de l'homme. Nombre d’entre elles s’inspirent des préceptes relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies dans leurs propres activités. Plusieurs ont déjà une certaine expérience du régime conventionnel mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et le plus souvent ont des appréciations favorables à formuler à cet égard. La plupart ont vu leurs efforts entravés par un manque général de ressources matérielles et humaines et ont été découragées par l’inaccessibilité apparente de l’information sur le mode de fonctionnement des instruments relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les problèmes liés au handicap. Ces résultats sont extrêmement encourageants. Ils montrent que l’adoption de l’optique fondée sur les droits de l’homme trouve son expression dans la conception que les ONG s’occupant de l’invalidité ont de leur mission puisque ces ONG s’intéressent au dispositif mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et sont désireuses de s’y associer. Ils font aussi ressortir les facteurs qui freinent un tel engagement. Pour compléter l’analyse, il serait bon d’examiner comment les ONG s’occupant des droits de l’homme de type traditionnel commencent elles-mêmes à inscrire l’invalidité dans le courant général des droits de l'homme. À n’en pas douter un processus de convergence est entamé. Le chapitre 11 passe en revue les expériences et les manières de voir des institutions nationales œuvrant en faveur des droits de l’homme et les facteurs qui déterminent leur attitude. Un questionnaire avait été envoyé à ces institutions et, dans ce cas aussi, le taux de réponse a été satisfaisant étant donné le délai fixé. L’examen des réponses révèle que les institutions nationales sont en fait très conscientes de la nécessité d’envisager l’invalidité dans l’optique des droits de l’homme. Beaucoup ont déjà établi des études et des rapports intéressants sur la question des droits de l’homme des personnes souffrant d’un handicap. Certains de ces documents ont joué un grand rôle dans la réforme des lois et des politiques nationales relatives à l’invalidité. Toutes les institutions qui ont répondu ont manifesté un vif intérêt pour la question ainsi que la volonté de développer leurs activités dans le domaine. C’est un résultat très positif et prometteur qui laisse bien augurer de l’avenir. Le chapitre 12 contient toute une série d’observations, de commentaires et de recommandations visant à améliorer l’utilisation future du dispositif mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. Par souci d’exhaustivité, elles sont destinées à des parties prenantes très diverses. La pratique des États eu égard aux rapports périodiques sur l’invalidité est assurément en progrès. Cette amélioration résulte certainement de l’attention croissante portée à l’invalidité et aux droits de l’homme au sein du système des Nations Unies depuis deux décennies, notamment en application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés. S’agissant des États parties, les auteurs font trois recommandations visant à accroître la visibilité de l’invalidité dans le régime conventionnel. Plus précisément, ils recommandent aux États parties a) d’intensifier leurs efforts en vue de faire régulièrement rapport sur les situations portant atteinte aux droits des personnes souffrant d’un handicap; b) de consulter les ONG s’occupant de l’invalidité lorsqu’ils établissent leurs rapports périodiques respectifs étant entendu qu’en définitive ces rapports relèvent exclusivement de leur compétence et c) d’envisager de désigner des personnes souffrant d’un handicap pour faire partie des six organes de surveillance. Les organes de suivi des traités effectuent dans l’ensemble un excellent travail dans le domaine de l’invalidité étant donné les ressources limitées dont ils disposent et le grand nombre de questions et de groupes dont ils doivent nécessairement s’occuper. L’esprit et la lettre des Règles pour l’égalisation des chances ont également eu un effet à cet égard. Les recommandations suivantes répondent à la volonté d’aider les organes de suivi à améliorer encore leur action concernant l’invalidité. En particulier, il est recommandé a) que les organes de suivi essayent d’égaler les bonnes pratiques du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et adoptent des observations générales sur la nature des obligations incombant aux États au titre de l’instrument pertinent en ce qui concerne les problèmes liés au handicap; b) qu’ils essayent d’égaler les bonnes pratiques du Comité des droits de l’enfant en prévoyant une journée de débat thématique, ou une séance analogue, consacrée à l’invalidité; c) que dans les listes de questions envoyées aux États parties par les organes de suivi qui publient de tels documents il soit demandé plus systématiquement des informations sur l’exercice des droits fondamentaux par les personnes souffrant d’un handicap, compte tenu des priorités thématiques qui seront fixées dans les observations générales; d) que le dialogue avec les États parties porte plus systématiquement sur des questions relatives à l’invalidité; e) que les conclusions mentionnent l’invalidité, le cas échéant, en vue de définir les domaines nécessitant une attention plus soutenue et de demander aux États parties de fournir de plus amples renseignements dans leurs rapports ultérieurs; f) que les conclusions soient utilisées plus systématiquement pour mettre en exergue les méthodes efficaces à l’intention de tous les partenaires. La Commission des droits de l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme ont montré l’intérêt qu’ils portaient à la question des droits de l’homme et de l’invalidité. C’est important d’un point de vue symbolique mais c’est aussi appréciable d’un point de vue pratique étant donné le rôle central joué par le Haut-Commissariat dans l’ensemble du dispositif mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Les recommandations formulées par les auteurs de l’étude à cet égard visent à renforcer cet intérêt. En particulier, il est recommandé que la Commission des droits de l’homme encourage le Haut-Commissariat a) à rendre plus accessible les données concernant l’utilité et le fonctionnement du dispositif des Nations Unies en matière de droits de l’homme sous l’angle particulier de l’invalidité en ajoutant à son site Web un élément consacré à l’invalidité (et des liens bien conçus et très complets sur les activités pertinentes d’autres secteurs des Nations Unies, des institutions spécialisées et des institutions nationales); b) à prévoir, après consultation des partenaires, une série d’études thématiques mieux ciblées et de manuels pratiques sur des sujets comme les droits de l’homme des personnes vivant en institution, le droit à l’éducation des enfants handicapés, le principe de la discrimination et la valeur de la diversité humaine du point de vue de la génétique, de la bioéthique et de l’invalidité ainsi que les questions relatives aux droits de l’homme liées à l’incapacité intellectuelle; c) à charger au moins un membre du personnel travaillant à temps complet de la question de l’invalidité et des droits de l’homme; d) à faire savoir qu’il accueille favorablement les demandes de stage émanant de personnes handicapées; e) à encourager les programmes universitaires relatifs aux droits de l’homme à s’intéresser plus activement à la question des droits de l’homme et de l’invalidité; f) à jouer un rôle prépondérant dans la promotion des droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap au sein du système des Nations Unies, compte dûment tenu du fait que toutes les institutions compétentes sont également parties prenantes en la matière. Il importe de continuer à intégrer de plus en plus la prise en compte de l’invalidité dans l’optique des droits de l’homme dans les activités de l’ensemble du système des Nations Unies, y compris dans les activités de développement pertinentes. Il faut aussi que, dans ce domaine, une stratégie à plusieurs volets soit adoptée par toutes les entités compétentes. Des indications plus abondantes de la part du HCDH pourraient faire avancer de façon tangible le processus d’intégration et améliorer les contributions des divers éléments du système. Il est en outre recommandé que le Haut-Commissariat étudie la possibilité de réunir les organes de suivi des traités pour qu’ils examinent l’applicabilité et l’apport potentiel de leurs instruments respectifs en ce qui concerne les problèmes liés au handicap. S’agissant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, il est recommandé qu’elle maintienne en le renforçant le processus d’intégration de l’invalidité en tant que question relevant des droits de l’homme dans ses activités et qu’elle envisage sérieusement la nomination d’un rapporteur spécial sur les droits fondamentaux des personnes souffrant d’un handicap. Une telle entité est nécessaire pour accroître la visibilité de l’invalidité considérée comme un problème de droits de l’homme et pour assurer la coordination en matière d’invalidité au sein du système mis en place dans le domaine des droits de l’homme. S’agissant des institutions nationales œuvrant en faveur des droits de l’homme, les auteurs de l’étude recommandent qu’elles envisagent sérieusement de créer un lieu de discussion ou un groupe de travail sur l’invalidité et les droits de l’homme, qui leur permettrait de mieux comprendre le rapport entre le problème de l’invalidité et la question des droits de l’homme et d’échanger d’utiles données d’expérience. Pour ce qui est de la société civile, il est recommandé que les ONG s’occupant de l’invalidité conjuguent leurs ressources et mettent sur pied un observatoire international des droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité ou un organisme analogue qui pourrait aider à améliorer l’information et les capacités en matière de droits de l’homme dans le secteur œuvrant en faveur des handicapés. Elles devraient nouer des liens étroits avec les ONG pour la protection des droits de l’homme de type traditionnel en vue de tirer des enseignements de leur expérience et aussi de les inciter à considérer l’invalidité comme une question relevant des droits de l’homme. Les auteurs de l’étude attirent l’attention sur une pratique recommandable: le financement par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement d’un projet sur les droits fondamentaux des enfants souffrant d’un handicap. Étant donné que la majorité des personnes souffrant d’un handicap vivent dans des pays en développement, ils estiment que d’autres pays donateurs devraient financer des projets relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de l’invalidité au titre de leurs programmes en faveur du développement, de la démocratisation et des droits de l’homme. Le chapitre 13 traite de la possibilité d’enrichir le système existant dans le domaine des droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité en adoptant un instrument thématique sur les droits des personnes souffrant d’un handicap. En novembre 2001, l’Assemblée générale a adopté une résolution d’une importance décisive tendant à créer un comité spécial, ouvert à tous les États Membres, ayant pour tâche d’examiner des propositions en vue d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées en tenant compte de l’approche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination et des recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du développement social. Les auteurs de l’étude estiment que les arguments en faveur d’une telle convention sont extrêmement convaincants. Un tel instrument permettrait de centrer l’attention sur l’invalidité et de concevoir des normes générales relative aux droits de l’homme adaptées à la situation particulière des personnes souffrant d’un handicap. Elle augmenterait la visibilité du problème de l’invalidité dans le cadre du système mis en place en matière de droits de l’homme. Elle présenterait des avantages pratiques pour tous les partenaires en ce sens que les États parties connaîtraient ainsi plus précisément leurs obligations dans le domaine de l’invalidité et que la société civile pourrait concentrer ses efforts sur un ensemble cohérent unique plutôt que sur six ensembles différents de normes. Ces avantages ont été exposés il y a longtemps par Leandro Despouy, Rapporteur spécial de la Sous-Commission, dans son étude intitulée «Les droits de l’homme et l’invalidité», publiée en 1992. Pour les auteurs de l’étude, cette convention est de nature à étayer – et non à fragiliser – le réseau existant des instruments relatifs aux droits de l’homme pouvant se rapporter à l’invalidité. Autrement dit, elle devrait permettre à l’organe de suivi concerné d’accroître ses compétences normatives en la matière ce qui, en retour, devrait favoriser l’intégration de l’invalidité dans le dispositif existant de protection des droits de l’homme. Une convention prendrait en compte collectivement les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel, mental ou intellectuel. Son élaboration devrait être l’occasion d’examiner la meilleure façon d’utiliser tous les droits de l’homme – civils et politiques ainsi qu’économiques, sociaux et culturels – en vue de réaliser la pleine participation des personnes souffrant d’un handicap à la vie sociale. La convention devrait prévoir des mesures de protection adéquates, en particulier pour les personnes souffrant d’un handicap qui vivent en institution. En résumé, l’Organisation des Nations Unies aborde une phase passionnante de ses activités dans le domaine des droits de l’homme et de l’invalidité. Les problèmes liés au handicap réintègrent la sphère des droits de l’homme. Les auteurs de l’étude ne doutent pas que les nombreuses suggestions et recommandations qu’ils ont formulées et qui sont évoquées ci-dessus permettront d’utiliser mieux et davantage les six instruments relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. Ils sont également convaincus qu’un instrument thématique ferait infiniment progresser la protection des droits des personnes souffrant d’un handicap tout en renforçant la capacité des instruments existants de répondre utilement aux besoins de ces personnes. |