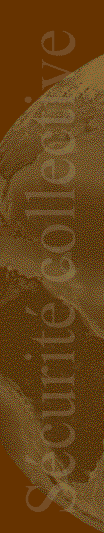Comment rendre le monde plus sûr ?
par Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU
Article paru dans l'édition
du journal Le Monde du 2 décembre 2004
Il y a quinze
ans, le monde était profondément divisé sur
les questions stratégiques de développement économique.
Les pays riches soutenaient le "consensus de Washington"
et le "règlement structurel" - des politiques que
n'appréciaient absolument pas les pays en voie de développement
eux-mêmes, et qui étaient violemment critiquées
par les organisations de la société civile des pays
industrialisés. On considérait que les Nations unies
étaient incompétentes sur ce sujet, ou pire, qu'elles
étaient le défenseur de gouvernements corrompus ou
prodigues des pays en voie de développement.
Aujourd'hui, les choses ont changé.
Le débat sur la politique de développement - y compris
parmi les pays industrialisés dominants - est fondé,
grâce à un large consensus entre les donneurs d'aide
et ceux qui la reçoivent -, sur ce dont chacun à besoin
pour atteindre le développement. Trois
réunions internationales déterminantes - le sommet
du Millenium en 2000, les conférences de l'ONU sur le financement
du développement à Monterrey et sur le développement
durable à Johannesburg en 2002 - ont conduit à un
consensus global remarquable sur la façon de développer
les économies, diminuer la pauvreté et protéger
l'environnement.
Les huit objectifs de développement
du Millenium, définis il y a quatre ans, constitueront les
points de référence pour mesurer les progrès
en 2015. Ils comprennent la diminution de moitié de la proportion
de gens souffrant d'extrême pauvreté et de faim ; la
scolarisation universelle au niveau de l'enseignement primaire ;
l'amélioration du pouvoir et du statut des femmes ; la réduction
radicale de la mortalité infantile et maternelle ; l'arrêt
de l'expansion du sida et de la malaria ; l'adoption par tous les
pays de politiques durables sur les plans politique et de l'environnement
; et - d'une importance cruciale si les autres objectifs sont atteints
- un partenariat global entre pays riches et pays pauvres, basé
sur l'ouverture des marchés, l'allégement de la dette,
l'investissement, et la définition de cibles soigneusement
choisies pour l'aide financière.
Il n'est absolument pas certain que ces objectifs
seront atteints en 2015, en particulier en Afrique subsaharienne,
où un effort beaucoup plus important est toujours nécessaire,
à la fois de la part des donneurs d'aide et de la part de
nombreux gouvernements africains. Mais au moins, dans la lutte qui
a pour but de construire un monde plus juste et plus prospère,
nous avons maintenant un accord sur ce qu'il est nécessaire
de faire.
Malheureusement, nous sommes encore loin
d'un consensus similaire sur la façon de rendre le monde
plus sûr. Dans ce domaine, les choses ont empiré au
cours de ces dernières années.
La solidarité globale contre le terrorisme,
qui a existé en 2001, a vite été remplacée
par d'âpres disputes à propos de la guerre en Irak
qui sont apparues comme révélatrices de divisions
sur des questions plus fondamentales. Comment pouvons-nous nous
protéger au mieux contre le terrorisme et les armes de destruction
massive ? Quand l'utilisation de la force est-elle acceptable et
qui devrait en décider ? La "guerre préventive"
est-elle parfois justifiée, ou n'est-ce simplement qu'une
agression parée d'un autre nom ? Et, dans un monde devenu
"unipolaire", quel rôle devraient jouer les Nations
unies ?
Ces débats ont pris le pas sur ceux
qui se posaient dans les années 1990. La souveraineté
d'un Etat est-elle un principe absolu ou la communauté internationale
a-t-elle une responsabilité pour prévenir ou résoudre
des conflits à l'intérieur des Etats - en particulier
quand ils impliquent des génoci-des ou d'autres atrocités
comparables ?
Il y a un an, pour suggérer des réponses
à de telles questions, j'ai désigné un groupe
de 16 personnalités éminentes, hommes et femmes, venues
de toutes les régions du monde et de différents domaines
de compétence - politique, militaire, diplomatique, économique,
sociale. Je leur ai demandé d'évaluer les menaces
que l'humanité affronte aujourd'hui et de proposer les changements
nécessaires, à la fois dans nos politiques et dans
nos institutions, pour leur faire face.
Le 2 décembre, ils remettent leur
rapport, Un monde plus sûr. Notre responsabilité partagée.
Les 101 recommandations qui le composent forment l'ensemble de propositions
le plus large et le plus cohérent que j'aie vu, afin de forger
une réponse commune aux menaces communes. Il comporte une
explication claire du droit d'autodéfense et en réaffirme
le principe ; des lignes directrices pour l'utilisation de la force
afin d'aider le Conseil de sécurité à traiter
de façon plus efficace et préventive à la fois
les massacres de masse à l'intérieur des Etats et
les "scénarios cauchemars" (tels ceux qui combinent
le terrorisme et les armes de destruction massive) ; un accord pour
une définition du terrorisme (que la communauté internationale
a esquivé jusqu'ici) ; et des propositions pour prévenir
une prolifération nucléaire en cascade et pour améliorer
la biosécurité. Le rapport contient aussi un ensemble
de propositions pratiques pour actualiser les organes de l'ONU -
y compris le Conseil de sécurité - et rendre l'organisation
plus efficace, en particulier dans la prévention et la construction
de la paix.
Par-dessus tout, il énonce clairement
les interconnexions de notre époque, dans laquelle les destinées
des peuples et les menaces auxquelles ils font face sont inextricablement
liées. Non seulement une menace contre une nation est une
menace contre toutes les nations, mais l'absence de réponse
à une menace peut saper notre défense contre toutes
les autres. Une attaque terroriste de grande ampleur au cœur
du monde industrialisé peut dévaster l'économie
mondiale, plonger des millions de gens dans une extrême pauvreté.
L'effondrement d'un Etat dans la région la plus pauvre du
monde peut créer un trou béant dans notre défense
commune contre le terrorisme et les maladies endémiques.
On ne pourra pas lire ce document et continuer
à croire que rendre ce monde plus sûr n'est pas en
réalité une responsabilité collective, ainsi
que l'intérêt de tous. Le rapport nous dit comment
le faire et pourquoi nous devons agir maintenant. La balle est manifestement
dans le camp des dirigeants politiques du monde. Je les exhorte
à se saisir de ce texte et à le mettre en pratique.
L'occasion est trop importante pour que nous la manquions.
Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau.
Page
principale
Accueil ONU
|